Témoignages anonymisés : un juste équilibre entre droit à la preuve et droit au procès équitable ?
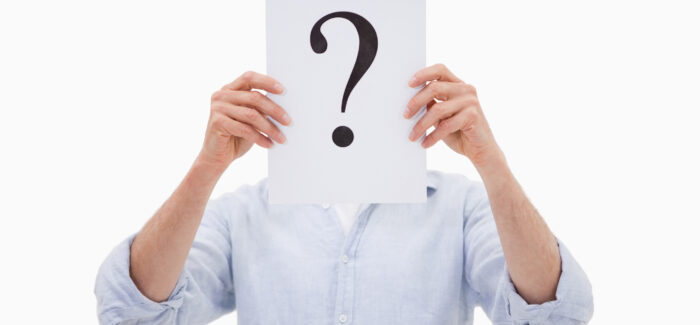
28 avril 2025
La Cour de cassation confirme l’admissibilité des témoignages anonymisés et précise leurs conditions.
Par une décision du 19 mars 2025 (1), la Haute juridiction s’est à nouveau prononcée sur l’utilisation des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori, dans le cadre des procédures prud’homales.
Désormais, même en l’absence d’éléments permettant de corroborer les témoignages anonymisés, le juge ne peut les écarter uniquement en raison de leur anonymisation, mais doit procéder à un contrôle de proportionnalité in concreto et à une mise en balance du droit à la preuve et du droit au procès équitable.
Rappel des règles en matière d’administration de la preuve en droit civil
Bien qu’en matière prud’homale la Cour de cassation considère que « la preuve est libre », son admissibilité reste encadrée par l’article 9 du Code de procédure civile qui précise que chaque partie doit « prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Ainsi, pour être recevable devant les juridictions civiles, la preuve doit en principe être licite et loyale (2).
Sous l’influence de la Cour européenne des droits de l’homme, la Haute juridiction, réunie en Assemblée plénière, a récemment fait évoluer sa jurisprudence sur le droit à la preuve en matière civile en jugeant que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats, dans deux arrêts du 22 décembre 2023 (3).
En présence d’une preuve obtenue de façon déloyale ou illicite, il appartient au juge, lorsque cela lui est demandé, « d’apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».
L’évolution de la jurisprudence sur les témoignages
La valeur probatoire des témoignages anonymisés a été consacrée pour la première fois en matière prud’homale dans deux arrêts du 19 avril 2023 (4).
S’appuyant sur les principes dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, art. 6 § 1 et 3), la Cour de cassation a considéré que : « Si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est connue de l’employeur, lorsqu’ils sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence. ».
Dans un premier temps, ces arrêts sont venus distinguer les témoignages anonymes, dont les auteurs sont inconnus de toutes les parties, des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori par la partie qui les produit en justice.
Le régime applicable à ces témoignages est donc différent :
-
- Témoignages anonymes: leur valeur probatoire est réduite, le juge ne pouvant fonder sa décision uniquement, ou de manière déterminante, sur de tels témoignages ;
-
- Témoignages anonymisés: leur portée probatoire est plus importante puisque le juge peut parfaitement fonder sa décision uniquement, ou de manière déterminante, sur ces témoignages pour autant qu’ils soient corroborés par d’autres éléments qui permettent d’en analyser la crédibilité et la pertinence.
Cette jurisprudence a été réaffirmée dans une affaire relative à une contestation d’expertise pour risque grave. A l’appui de sa demande d’expertise, le Comité Social et Économique (CSE) avait produit divers éléments de preuve, dont plusieurs témoignages anonymisés que la Cour de cassation avait jugé recevables car corroborés par d’autres éléments (5).
Rappel des faits et de la procédure
Dans l’affaire ayant conduit à la décision du 19 mars 2025, un salarié, embauché en CDI en qualité de Rectifieur, a été licencié pour faute grave après des signalements de collègues dénonçant son comportement agressif (menaces, remarques désobligeantes, propos violents, intimidations). Une enquête interne a confirmé ces accusations, conduisant l’employeur à lui proposer un poste de nuit.
Le salarié a refusé ces nouveaux horaires, ce qui a suscité de nouvelles plaintes et certains salariés ont menacé de démissionner. L’employeur a alors procédé à son licenciement pour faute grave, invoquant dans le courrier de licenciement, son obligation de sécurité à l’égard des autres salariés.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Pour prouver la réalité de la faute, l’employeur a produit deux constats d’audition établis par un commissaire de justice reprenant le contenu des auditions effectuées par ce dernier, de cinq témoins dont l’identité n’est jamais mentionnée, à leur demande.
La cour d’appel de Chambéry (6), au visa de l’article 16 du Code de procédure civile et de l’article 6 § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a refusé de prendre en compte ces constats, considérant qu’ils étaient dépourvus de valeur probante. L’employeur ne disposant d’aucun autre élément de preuve, les juges du fond ont jugé que la faute grave n’était pas démontrée.
Décision de la Cour de cassation : Précision sur l’admissibilité des témoignages anonymes
La Cour de cassation casse et annule cette décision, considérant que :
⇒ relève de l’admissibilité des preuves et non de l’examen au fond le fait de déclarer non probante une pièce au motif qu’elle n’a pas été contradictoirement débattue ;
⇒ la production de ces témoignages anonymisés était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur, par ailleurs tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et que l’atteinte portée au caractère équitable de la procédure était strictement proportionnée au but poursuivi :
-
- « la teneur des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs, mais dont l’identité était connue de l’employeur et de l’huissier de justice qui avait recueilli ces témoignages, avait été portée à la connaissance du salarié» ;
-
- « ces témoignages avaient été recueillis par un huissier de justice responsable de la rédaction de ses actes pour les indications matérielles qu’il a pu lui-même vérifier en application des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 alors applicable» ;
-
- « il n’était pas contesté que le salarié avait déjà été affecté à une équipe de nuit pour un comportement similaire à celui reproché dans la lettre de licenciement».
Par cet arrêt, la chambre sociale distingue tout d’abord la recevabilité d’un moyen de preuve de l’appréciation, au fond, de sa valeur probatoire. La cour d’appel avait en effet considéré que la preuve n’avait pas de valeur probatoire en raison de son anonymisation. La Cour de cassation rappelle donc qu’avant d’évaluer la valeur des preuves, les juges doivent préalablement s’assurer de leur recevabilité.
Dans un second temps, elle étend l’admissibilité des témoignages anonymisés en admettant leur recevabilité même en l’absence d’autres éléments permettant de les corroborer.
Deux hypothèses sont ainsi progressivement dégagées par la Cour de cassation
Hypothèse 1 – Des témoignages anonymisés, parmi d’autres éléments de preuve, sont versés aux débats :
S’ils sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence, et si l’anonymisation a posteriori des témoignages a pour vocation de protéger leurs auteurs, dont l’identité est connue de la partie qui les produit, les témoignages anonymisés sont admissibles. Les juges pourront ensuite en apprécier souverainement la valeur probatoire.
Hypothèse 2 – Seuls des témoignages anonymisés sont versés aux débats :
Le juge doit apprécier si la production de ces témoignages porte atteinte au caractère équitable de la procédure. Si la preuve est indispensable et que l’atteinte aux droits de la défense est proportionnée, ces témoignages peuvent être admis.
Un contrôle de proportionnalité in concreto doit donc être opéré par les juges. En effet, l’équilibre entre les parties suppose qu’elles puissent présenter leur cause sans être placées dans une situation de net désavantage.
La Haute juridiction rappelle ici que la liberté de la preuve n’est pas absolue. L’admission d’un élément probatoire (par exemple des témoignages anonymisés) ne doit pas avoir pour conséquence de violer les droits de la défense et le droit à un procès équitable de la partie adverse.
Ainsi, les atteintes aux droits de la défense doivent-elles être compensées par des garanties procédurales suffisantes.
Le juge doit donc :
-
- Examiner la procédure dans son ensemble pour vérifier que les droits des parties ont été respectés ;
-
- S’assurer que les atteintes au principe du contradictoire notamment sont compensées par d’autres garanties.
La chambre sociale s’inspire ici des principes dégagés par la CEDH, et notamment, de l’arrêt du 19 septembre 2017 relatif à l’absence de violation du droit à un procès équitable d’un fonctionnaire n’ayant pas pu consulter des pièces classifiées (7).
Il avait en effet déjà été considéré qu’eu égard à la procédure dans son ensemble, à la nature du litige et à la marge d’appréciation dont disposent les autorités nationales, les limitations subies par le requérant dans la jouissance des droits qu’il tirait des principes du contradictoire et de l’égalité des armes ont été compensées de telle manière que le juste équilibre entre les parties n’a pas été affecté au point de porter atteinte à la substance même du droit de l’intéressé à un procès équitable.
Le fait que le haut fonctionnaire n’ait pas eu accès aux documents classifiés ayant conduit au retrait de son attestation de sécurité constituait certes une atteinte à ses droits, mais cette atteinte était limitée et compensée par d’autres droits (8).
Désormais, même en l’absence d’éléments complémentaires, les témoignages anonymes peuvent être recevables à condition qu’ils soient jugés indispensables à l’exercice du droit à la preuve et que l’équilibre des droits des parties soit respecté.
Dans son avis sur l’arrêt du 19 mars 2025 (9), l’avocate générale relève l’importance de plusieurs éléments de contexte ayant conduit la Cour de cassation à casser l’arrêt d’appel.
Premièrement, si les témoignages anonymisés étaient les seuls éléments produits par l’employeur, ils avaient été reçus par un commissaire de justice, officier ministériel assermenté dont les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire, ce qui démontrait notamment qu’il ne s’agissait pas de témoignages fictifs.
Deuxièmement, les faits de violences physiques et verbales reprochés au salarié licencié venaient appuyer leurs craintes concernant la peur de représailles. Enfin, le changement d’horaires du salarié décidé préalablement au licenciement en raison des nombreuses plaintes de ses collègues témoignait de la nécessité pour l’employeur de procéder au licenciement.
En conséquence, la Cour de cassation, procédant elle-même au contrôle de proportionnalité, a estimé que la production des témoignages anonymisés était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs (C. trav., art. L.4121-1 et L.4121-2) et que l’atteinte portée au principe d’égalité des armes était strictement proportionnée au but poursuivi (10).
Impacts pratiques
Cette décision a des implications majeures sur le déroulé des litiges prud’homaux.
Elle allège la charge de la preuve pesant sur l’employeur en matière disciplinaire (C. trav., L. 1232-1). Il est désormais admis qu’on puisse ne verser aux débats que des témoignages anonymisés pour démontrer le bien-fondé d’une sanction, sous réserve de démontrer :
-
- Connaissance de l’identité des auteurs des témoignages: L’anonymisation doit être réalisée a posteriori et l’identité des témoins doit être connue de l’employeur. Il est possible de proposer aux juges de leur remettre une version non-anonymisée des témoignages, à condition que l’identité des auteurs ne soit pas révélée à la partie adverse ;
-
- Nécessité de l’anonymisation: L’anonymisation doit être rendue indispensable par la nécessité d’assurer la protection des témoins ;
-
- Apports, dans la mesure du possible, d’autres éléments de preuve : l’employeur a tout intérêt à verser d’autres éléments de preuve aux débats. S’il ne dispose pas d’éléments complémentaires, le recours à un commissaire de justice est recommandé pour renforcer la valeur des témoignages.
Si cette jurisprudence qui renforce la protection des témoins est de nature à encourager la dénonciation de faits graves auprès de l’employeur puisque les salariés n’ont pas à craindre de représailles de l’auteur des faits dénoncés, elle préserve également les intérêts de l’employeur qui déciderait sur le fondement de ces seuls témoignages de prendre une sanction à l’encontre du salarié fautif.
AUTEURS
Marie-Laure Tredan, avocate Counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats
Manon Bachès, avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats
(1) Cass. Soc., 19 mars 2025, n°23-19.154
(2) Répertoire de droit du travail – Preuve de la cause réelle et sérieuse, Alexandre FABRE, janvier 2025
(3) Cass. Soc., 22 décembre 2023, n°20-20.648 ; n°21-11.330
(4) Cass. Soc., 11 décembre 2024, n°23-15.154
(5) Cass. Soc., 19 avril 2023, n°21-20.308
(6) CA Chambéry, 8 mars 2022, n°20/01449
(7) CEDH 19 septembre 2017, n°35289/11, Régner c. République Tchèque
(8) Défenseur des droits – Arrêt relatif à la non-violation du droit à un procès équitable
(9) Avis de Madame GRIVEL, Avocate Général
(10) Notice au rapport relative à l’arrêt du 19 mars 2025
Previous Story
La relation de travail mise à nue ou quand l’employeur est obligé de tout dévoiler au salarié
Next Story
This is the most recent story.
Related Posts
Preuve de la participation à une entente : insuffisance de la seule réception ... 5 juillet 2016 | CMS FL

Le harcèlement moral : l’épreuve de la preuve... 10 juin 2013 | CMS FL
RGPD et droit de la preuve en matière de discrimination : un équilibre diffici... 13 février 2025 | Pascaline Neymond

De l’usage de la langue française dans les relations de travail... 11 mai 2015 | CMS FL
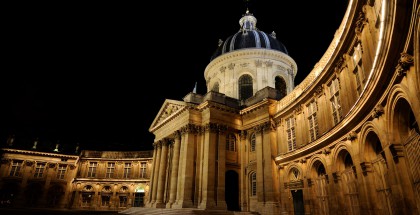
Alcool au travail : à quelles conditions ?... 14 août 2019 | CMS FL Social

Conditions et limites de l’appropriation par un salarié des courriels profess... 6 février 2023 | Pascaline Neymond

Demande de sursis à statuer devant une juridiction de sécurité sociale dans l... 15 avril 2022 | Pascaline Neymond

L’employeur peut-il consulter les SMS de ses salariés ?... 25 mars 2015 | CMS FL

Articles récents
- Témoignages anonymisés : un juste équilibre entre droit à la preuve et droit au procès équitable ?
- La relation de travail mise à nue ou quand l’employeur est obligé de tout dévoiler au salarié
- Exercice d’une activité réglementée : n’omettez pas de vérifier que vos salariés sont en possession des diplômes nécessaires !
- Stop the clock : l’impératif de compétitivité reprend le dessus sur les obligations des entreprises en matière de durabilité
- Activité partielle de longue durée rebond : le décret est publié
- Quand le CSE stoppe le déploiement de l’IA
- A l’approche du mois de mai, comment gérer les ponts et les jours fériés ?
- Refus d’une modification du contrat de travail pour motif économique : attention à la rédaction de la lettre de licenciement !
- Statut de cadre dirigeant – attention aux abus !
- Licenciement pour insuffisance professionnelle d’un salarié protégé : le Conseil d’Etat remplace l’obligation préalable de reclassement par une obligation d’adaptation


